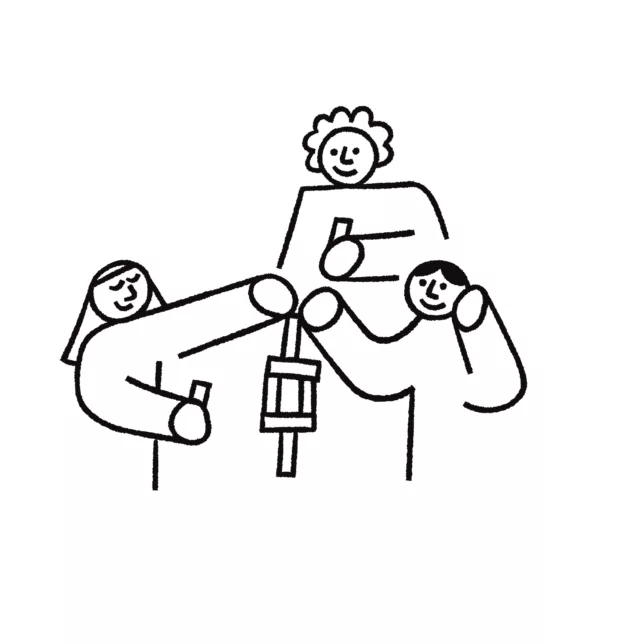Aux origines de la thérapie familiale systémique
C’est aux États-Unis que naît la thérapie familiale à la fin des années 1940. Si, au départ, les premiers travaux considèrent séparément les individus d’une même famille, les travaux d’anthropologues fonctionnalistes avancent déjà que les pratiques familiales assurent une fonction précise par rapport au corps social. Apparaît ensuite la théorie générale des systèmes de Bertalanffy qui considère la famille comme un système en état d’équilibre, et les symptômes comme des rétroactions négatives. Plusieurs écoles de thérapie familiale voient le jour, influencées par la théorie des systèmes et la cybernétique. En 1960, l’école de Palo Alto, avec Grégory Bateson, identifie les troubles de la communication et la notion de double contrainte en considérant le groupe familial dans son ensemble : tout individu humain fait partie d’un ensemble d’éléments en interaction. Au premier rang du système humain se trouve la famille, avec ses règles de fonctionnement.
Systémie familiale : définition et notions fondamentales
Définition
Dans la systémie familiale, c’est l’ensemble des relations (conjugale, parent(s)-enfant, fraternelle, etc.), leur interdépendance, leurs effets sur la dynamique familiale qui sont prises en compte. Ce n’est donc pas la personne isolée qui décide du système, mais la dynamique d’interactions familiales. Dès lors, les troubles psychologiques et comportementaux résultent d’un dysfonctionnement interactionnel de la famille. On peut illustrer la systémie familiale par la figure du mobile : chaque membre d’une famille est suspendu à la même structure en bois. Les paroles et les actes de chacun ont des répercussions sur les autres. La structure n’est pas figée, elle bouge au gré des événements externes et internes à la vie de la famille. Le système familial cherche pourtant sans cesse à retrouver un nouvel équilibre relationnel.
En systémie familiale, le praticien ne va pas chercher les causes dans le passé familial. C’est dans les relations intra-familiales – ici et maintenant – que l’on va trouver un sens et des solutions aux souffrances rencontrées. Quand il y a discorde au sein du couple, échec scolaire, troubles du comportement, jalousie dans une fratrie, drogue, alcoolisme, violences, il arrive souvent que la solution aux problèmes de famille soit la famille elle-même.
Notions fondamentales
La famille est un système vivant
On ne peut pas en isoler chacune des parties (principe de totalité) et le tout n’est pas égal à la somme des parties (principe de non-sommativité). Les familles possèdent des limites et contrôlent l’information qui passe à travers celles-ci. Elles sont organisées, font partie elles-mêmes d’un plus vaste système de société avec aussi des sous-systèmes (fratrie, génération). L’environnement joue donc un rôle fondamental dans la systémie familiale.
Famille et processus d’auto-régulation
Quand il y a des difficultés relationnelles dans la famille, des tensions se créent, menant à des alliances et des oppositions. Cela donne parfois lieu au phénomène du bouc émissaire, qui va servir à évacuer la violence endémique au sein de la famille. C’est lui qui est pointé comme le symptôme, mais il s’agit en fait d’un régulateur homéostasique (l’homéostasie étant la caractéristique d’un écosystème résistant aux changements et conservant un état d’équilibre).
Notion de la double contrainte
En tant que système, la famille fait face à deux exigences : rester ensemble et permettre à chacun de ses membres de se différencier. De ce fait, la demande de changement croise en permanence celle de rester identique (non changement).
Posture du thérapeute
En systémie familiale, le thérapeute se pose comme ignorant (il « ne sait pas », ne détient pas la vérité absolue), engagé et proche. Le patient est vu comme volontaire, logique et utile.